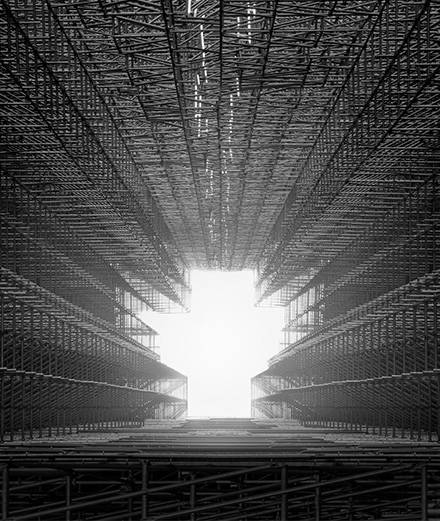Le pop art influença de nombreux mouvements et courants artistiques, et l’avant-garde architecturale italienne n’échappa pas au vent de liberté qu’il fit souffler dans ce pays. Le designer Ettore Sottsass en fit la preuve avec sa fameuse machine à écrire Valentine en plastique thermoformé rouge pompier, pop à souhait, qu’il dessina en 1969 pour la firme Olivetti, accompagnée de son affiche publicitaire du même acabit.
De fait, dès son premier périple aux États- Unis, en 1956, Sottsass perçoit les prémices du pop art. Puis, à l’orée des années 60, il assiste à sa montée en puissance, observant la manière dont l’art s’imprègne des symboles puissants de l’industrie et de la grande production, alors inexistants en Europe. “Il y avait ces journaux américains extrêmement volumineux, surtout le dimanche, qui transpiraient la culture pop, et c’est à ce moment-là que commençait justement à naître, en Amérique, cet intérêt pour l’imagerie populaire. Ça m’a beaucoup marqué”, relatait Ettore Sottsass, ajoutant : “Ce qui m’a passionné, c’est que les artistes prenaient pour thèmes les sujets du quotidien, la vie de tous les jours. La banalité était leur univers. À la place des madones, des christs, ils s’intéressaient à une coupe de fruits, à une boîte de soupe, à une voiture. Leur écriture était le langage de la rue.”


Ettore Sottsass en sera durablement marqué, comme en témoignera toute sa production à venir, à l’instar de sa série de céramiques Menhir, Ziggurat, Stupas, Hydrants & Gas Pumps présentée en 1967 à Milan : “J’ai été très influencé par la culture beat et hippie américaine, parce que c’était une façon de faire la révolution très différente de la manière européenne”, observait le designer, qui fut aussi un grand ami du poète Allen Ginsberg, l’un des chefs de file de la Beat generation. “Chez nous, dans les années 60, elle était violente, on brûlait des choses, on dressait des barricades. La révolution beat et hippie était tout à fait différente : les Américains avaient développé un autre type de contestation, très pacifique.” L’architecte qu’il deviendra en retiendra d’ailleurs la leçon : “Je pense que pour être architecte, il faut devenir très doux, très calme, avec une très grande sensibilité à la vie”, dira-t-il.
En 1987, à Ridgway, dans le Colorado (États-Unis), il construit une maison pour le collectionneur et galeriste expert en photographie Daniel Wolf. “Je crois que l’architecture est avant tout un lieu d’existence. Mon père [qui était également architecte] m’a laissé en héritage une manière de penser l’architecture comme un lieu protecteur, chaleureux, extrêmement privé, à l’opposé de l’architecture monumentale, indiquait Ettore Sottsass. La maison Wolf est perchée à 3 000 mètres d’altitude. Il y a là-haut des amplitudes de température de plus de trente degrés, ce qui fatigue considérablement le marbre. Ainsi, j’ai dû faire des recherches compliquées pour trouver des types de marbre résistant. Cet exemple illustre vraiment ce que j’entends par architecture, l’architecture comme lieu de vie. Et une vie qui s’applique autant aux gens qu’aux matériaux.”


Les deux caractéristiques principales du style Sottsass sont les formes géométriquement simples, empilées tel un jeu de construction, et les couleurs vives. Comme il le fait avec le mobilier, l’homme joue l’équilibriste, n’hésitant pas à juxtaposer les volumes élémentaires. Pas de doute non plus quant à l’emploi d’une palette détonante : “Chez moi, la couleur perpétue le souvenir de cette joie liée au temps de l’enfance. Les enfants adorent la couleur. C’est une matière quasi linguistique à la disposition de ceux qui ne savent pas encore verbaliser. La couleur est une expression de la vie.” Ces deux principes essentiels, il les réitère à l’envi par la suite, avec la Yuko House, à Tokyo, ou avec la Casa Cei, à Empoli, près de Florence, dont l’immense toit rouge décolle de l’édifice comme s’il allait s’envoler.
Si l’architecture, pour Sottsass, devait à tout prix s’écarter du vocabulaire académique, il tenait, en revanche, à ce qu’elle devienne un lieu de “plaisir esthétique” et de “satisfaction sensorielle”. Pour s’en persuader, il n’y a qu’à contempler la villa Olabuenaga, sur l’île de Maui, dans l’archipel d’Hawaï (États-Unis). Cette magnifique demeure fut construite par ses soins pour Adrian Olabuenaga et Lesley Bailey, fondateurs d’ACME Studios. Ce sera également le cas, bien évidemment, pour les demeures qu’il dessine pour ses deux galeristes “officiels”, le Suisse Bruno Bischofberger et le Néerlandais Ernest Mourmans, respectivement à Zurich (Suisse) et à Lanaken (Belgique). Flopée de riches commanditaires pour lesquels, en cas de critique négative, il trouvera illico une parade : “On peut m’accuser d’avoir fait des maisons pour des milliardaires, c’est vrai, mais je peux aussi dire que ces milliardaires étaient des galeristes, de grands collectionneurs, c’est-à- dire des intellectuels avec lesquels je pouvais parler, je pouvais discuter...”