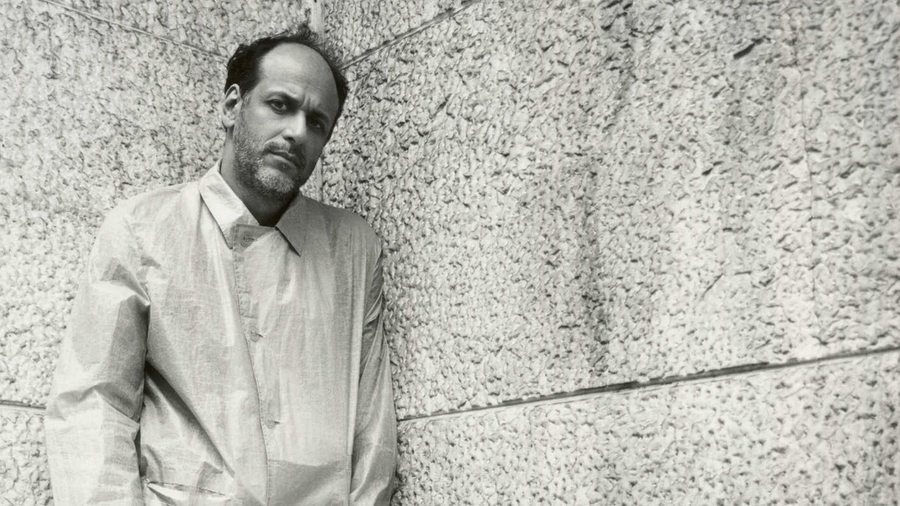Refaire Suspiria, le classique absolu du film d’horreur seventies ? Mais quelle idée ! Il fallait bien un garçon de la trempe du Sicilien Luca Guadagnino (Call Me by Your Name, A Bigger Splash) pour s’emparer de cette œuvre, ce geste de cinéma culte que le réalisateur Dario Argento avait extirpé de sa folie créatrice en 1977. L’histoire que met en scène Luca Guadagnino est à peu près la même, celle d’une jeune Américaine ingénue nommée Susie Bannion débarquant dans une inquiétante compagnie de danse, où elle découvre bientôt les maléfices qui s’y jouent sous l’emprise de forces occultes de plus en plus insistantes. Y aura-t-il des sorcières ? Pourquoi pas. Le film original, scandé par la bande-son hurlante du groupe Goblin, tranchait dans le vif en stylisant à l’extrême la violence et en jouant sur toutes les phobies liées au corps des jeunes femmes, aux intrusions non consenties. On se souvient du rouge et du rose, de la matière de l’image comme déchirée, des morsures et des couteaux. Une expérience sensorielle inoubliable et dérangeante, sous l’influence de la tradition du giallo initiée par Mario Bava.
Guadagnino a reçu le film comme un uppercut quand il était adolescent et ne l’a jamais oublié. Il en propose aujourd’hui un remake sans peur et sans reproche, où la trame principale est étirée, plusieurs personnages largement mis en avant – notamment celui d’un psy désormais central – et où son obsession personnelle pour les corps et leurs limites joue à plein. Mais il ne faut pas rechercher ici les traces de la sensualité conquérante et solaire de Call Me by Your Name. Les corps sont contraints, essorés, percés de toutes
parts, mais ils expriment aussi leur puissance et leur potentiel majestueux. Alors que Dario Argento en faisait simplement un fond pour emporter son récit ailleurs, la danse est d’ailleurs largement mise en avant dans ce Suspiria nouvelle manière, avec des chorégraphies du Franco-Belge Damien Jalet. Elle structure notre rapport au personnage principal interprété par une flamboyante Dakota Johnson, mais aussi à celui de Tilda Swinton, parfaite dans son rôle de directrice de compagnie glaciale et néanmoins bouillonnante sous la surface. Une incroyable séquence liant la danse avec l’expérience physique de la mort et de la destruction du corps (nous n’en dirons pas plus, spoiler oblige) reste longtemps en mémoire.


Long de plus de deux heures trente, soit une heure de plus que son ancêtre quadragénaire, ce Suspiria se laisse parfois emporter par son ambition en flirtant avec le too much. Mais le too much est aussi son sujet, surtout que Guadagnino sait retomber sur ses pieds, assumer son désir baroque, montrer qu’il peut aller au bout de ses fantasmes, jusqu’à une apothéose glorieuse et sanguinolente rythmée par la musique de Thom Yorke, qui renoue ici avec ses tendances bruitistes. Surtout, le cinéaste ne rate pas l’occasion de filmer un monde presque exclusivement féminin, où la violence vient de loin – des abîmes de l’Histoire – et où quelque chose de l’ordre d’une fascination pour les symboles utérins se déploie férocement. Il faudra un peu de temps pour se remettre de ce film monstre et le comprendre vraiment. Nous avons commencé par en discuter avec son auteur, qui l’a présenté en avant-première le mois dernier au Festival de Venise.
Numéro : D’où est venue l’idée de mettre en scène un remake de Suspiria, juste après Call Me by Your Name ? Le changement de ton est radical.
Luca Guadagnino : En fait, c’est plutôt l’inverse qui s’est passé. Je suis vraiment passé de A Bigger Splash à Suspiria. J’ai eu le projet d’adapter le film de Dario Argento il y a longtemps. Durant les cinq dernières années, j’ai consacré beaucoup d’énergie à essayer de le rendre possible, en tant que réalisateur et producteur. J’ai énormément travaillé dans ce but. Pour Call Me by Your Name, c’était très différent puisque je n’étais pas censé réaliser le film écrit par James Ivory. J’ai d’abord développé le projet dans le cadre de mes activités de producteur. À la dernière minute, on m’a demandé d’en devenir le réalisateur et j’ai accepté. Donc, pour moi, la vraie chronologie n’est pas celle que vous connaissez. Les choses ne sont jamais ce qu’elles semblent être. Dans nos vies, nous prenons des décisions qui ont du sens pour nous, tandis que pour ceux qui ne nous connaissent pas, elles ont l’air étranges.
Avez-vous d’autres exemples vous concernant ?
Eh bien par exemple, ceux qui me connaissent bien savent que j’ai toujours été complètement dévoué au genre du film d’horreur. J’ai grandi en adorant les films d’horreur et j’ai toujours voulu en faire. Donc, pour moi, il est complètement naturel de réaliser le remake d’un classique du genre aussi célébré. J’ai vu beaucoup de films faits par de nombreux réalisateurs, maisSuspiria m’a donné un sentiment nouveau, il m’a appris que, en ce qui concerne la manière de façonner et de présenter une histoire, tout est possible. Pour moi, cela a été la plus grande leçon que j’ai tirée de ce film.
“Tous mes films ont tourné de manière profonde et forte autour de personnages de femmes qui ont du pouvoir. Cela m’attire énormément.”
Quelle a été votre approche en termes de récit ? Vous situez le film à Berlin, l’année où Suspiria est sorti en salles : 1977.
Avec le scénariste David Kajganich, nous avons abordé la construction du film par le biais de l’année et du lieu. 1977, Berlin... Nous nous sommes demandé quel pouvait être le climat à cet endroit-là et à ce moment-là, quelque chose qui aurait à voir plus ou moins ouvertement avec les conséquences de l’histoire de la première moitié du XXe siècle. Nous avions envie de capter la paranoïa intense attachée à ce moment de l’Histoire. Pour y parvenir, il fallait vraiment se concentrer sur l’idée d’oppression, puis la faire infuser dans les personnages et dans le récit.
Le film original de Dario Argento était fou, comme un long cri d’images, de corps et de sons. J’ai l’impression que vous n’avez pas cherché à le copier, mais à vous inspirer de sa liberté.
J’aime bien ce que vous dites ! J’essaie toujours de m’impliquer entièrement dans un film en tant que personne. Je creuse à l’intérieur. Je ne fais pas du cinéma parce que c’est un travail, mais plutôt pour exprimer ma vision du monde... et peut-être de moi-même.
Quelle vision du monde et de vous- même défendez-vous dans Suspiria ?
J’espère que les gens peuvent deviner laquelle sans que je doive forcément m’expliquer.
“Je ne peux pas réaliser un film autrement qu’en ayant un contrôle total.”


C’est toujours mieux de laisser parler le film. Dans ce cas, évoquons la comédienne principale. Il s’est manifestement passé quelque chose entre Dakota Johnson et vous. Elle est incroyable, à la fois dans les scènes de danse et dans le jeu. Vous l’aviez déjà choisie pour A Bigger Splash.
Pour ce film, grâce à notre relation instinctive, Dakota Johnson est allée très loin. Nous nous comprenons sans avoir besoin d’entrer constamment dans les détails. Elle a confiance en moi, j’ai confiance en elle. Je sais que Dakota est une femme d’un grand courage, qui a le désir d’explorer la complexité qui se trouve en elle. C’est la raison pour laquelle je l’aime beaucoup.
Avec elle, ainsi qu’à travers le personnage joué par Tilda Swinton,Suspiria plonge dans la psyché féminine.
Tous mes films ont tourné de manière profonde et forte autour de personnages de femmes qui ont du pouvoir. Cela m’attire énormément.
Avec Suspiria, nous sommes très loin du naturalisme doux de Call Me by Your Name, mais plus proche du baroque. Comment définir votre style avec des projets aussi différents ?
Vous me demandez de définir mon style ? En fait je ne comprends pas vraiment le concept de style en cinéma. À mon avis, pour un réalisateur, il est plus important de penser en termes de forme et de langage. Le style a peut-être davantage à voir avec la surface, quelque chose d’un peu superficiel, tandis que la forme est une manière d’utiliser les outils du cinéma.
“Le sujet du film, c’est le conflit entre l’irrationnel et le rationnel, la manière dont l’irrationnel peut faire exploser notre vie rationnelle.”
L’ambition visuelle du film est très grande. Quelle est votre méthode ? Avez-vous des références en tête quand vous travaillez ?
Quand je crée, j’essaie d’abord de me souvenir des chocs émotionnels que m’ont procurés certaines œuvres, de ce que j’ai ressenti en regardant une peinture, un film ou même autre chose. J’aime bien penser en dehors du cadre et partager mes réflexions avec mes collaboratrices et collaborateurs, avec qui je travaille depuis longtemps. Ils comprennent notre mission. Pour Suspiria en particulier, nous avons beaucoup regardé les peintures de Balthus, afin de cerner le genre de lumière et de couleurs dont nous avions envie.
Quand vous tournez un film aussi ambitieux et dont les enjeux financiers sont réels, restez-vous un cinéaste indépendant ? Un film qui coûterait deux millions d’euros et un autre qui en coûterait dix, les aborderiez-vous de la même manière ?
Je les aborderais comme s’ils étaient jumeaux. Je ne peux pas réaliser un film autrement qu’en ayant un contrôle total. Si ce n’est pas le cas, je refuse le projet. Je suis en charge de ce que je porte à l’écran. Je ne crois pas que ce soit si rare que cela aujourd’hui. Beaucoup de réalisateurs dans le monde sont dans cette position, des cinéastes qui se donnent eux-mêmes du pouvoir pour contrôler leur art. C’est une décision que l’on peut prendre. Il suffit de la prendre, d’ailleurs. Donc je ne suis pas en lutte pour ma liberté : je fais ce que je veux. Et je dois dire que j’ai des partenaires très intelligents, avec lesquels les conversations sont claires. Il faut être certain que les gens qui sont en face de vous comprennent ce que vous voulez dire, c’est la clé.
Suspiria décolle à plusieurs moments, et notamment lors d’une scène intense que nous ne dévoilerons pas, vers la fin, mise en scène comme un ballet horrifique.
Le sujet du film, c’est le conflit entre l’irrationnel et le rationnel, la manière dont l’irrationnel peut faire exploser notre vie rationnelle. Que se passe-t-il quand les deux se percutent ? J’ai essayé de filmer cette rencontre étrange. J’ai pensé à certaines expériences artistiques des années 70 comme les performances de Hermann Nitsch, l’une des figures de l’actionnisme viennois, qui résonnaient de manière très forte avec le présent de cette époque-là.
“Au fil des décennies, de manière constante, les gens affirmaient que le cinéma était en train de mourir. Une fois, c’était à cause de la télé, une autre fois, à cause de la VHS puis du DVD... Pourtant, nous recherchons collectivement des histoires pour comprendre un peu mieux nos vies. Même s’il n’est plus seul, le cinéma n’a pas l’air vraiment mort.”
Bande-annonce de “Suspiria” de Luca Guadagnino.
Essayer d’aller aussi loin aujourd’hui, c’est très osé : l’art et le cinéma sont devenus plus policés. Êtes-vous nostalgique des époques de plus grande liberté ?
Je ne sais pas si j’ai la nostalgie du moment où le cinéma pouvait être un peu fou... En fait, j’essaie autant que possible de ne pas être une personne qui ressent de la nostalgie. Je cherche avant tout des connexions. Quand je vois certains films que j’ai toujours aimés, comme ceux des nouvelles vagues européenne ou japonaise, le cinéma français des années 60, ou encore le “New British Cinema” et certains réalisateurs néerlandais qui ont débuté dans les seventies, je ressens cette connexion avec mes propres désirs d’artiste. Donc, j’essaie de la retrouver et de l’intégrer à mon cinéma. Cela n’a rien à voir avec la nostalgie. Je crois que je rejette la nostalgie. Je crée d’autres circuits.
Voyez-vous beaucoup de films d’aujourd’hui ?
Je vois beaucoup de films de toutes les époques, je ne suis pas snob, je suis comme tout le monde. Je sais aussi qu’il est important pour une personne qui essaie de faire de l’art de comprendre où est sa place dans la création d’aujourd’hui et à l’intérieur des nouvelles expressions du cinéma. Il ne faut pas rester arc-bouté sur sa propre perspective, mais au contraire tenter d’être un peu en surplomb, au-delà du jugement. Il faut avoir la vue claire. De cette manière, on peut trouver de la beauté partout, on peut se nourrir de films magnifiques. Je n’ai pas envie de nommer les gens pour ne pas réduire ce que je dis à un exemple, mais je dirais que je cherche constamment les expériences les plus désirables.
En tant que réalisateur, vous avez acquis une grande liberté, Suspiria le démontre très bien, mais le cinéma, lui, n’est peut-être plus le lieu privilégié qu’il a été pour les générations précédentes. Les séries et les images venues d’Internet occupent une place importante dans les imaginaires. Comment y faire face ?
Je suis un peu méfiant et timide quand il s’agit de parler d’un sujet aussi important. Il me faudrait du temps pour y répondre vraiment. La question est complexe. Je dirais cela : j’ai grandi dans un climat où, au fil des décennies, de manière constante, les gens affirmaient que le cinéma était en train de mourir. “Le cinéma est mort ! Le cinéma est mort ! Le cinéma est mort !” Une fois, c’était à cause de la télé, une autre fois, à cause de la VHS puis du DVD, maintenant on parle beaucoup de la VOD et du streaming. Et pourtant, je remarque que nous recherchons collectivement des histoires, des récits, pour comprendre un peu mieux nos vies. Nous avons besoin tous les jours de ces bouffées d’air frais. Donc, même s’il n’est plus seul, le cinéma n’a pas l’air vraiment mort à mes yeux. Il nous permet toujours de mieux comprendre nos existences à travers un récit et des images.
Si on vous donnait la même liberté qu’au cinéma, auriez-vous envie de réaliser une série comme certains de vos collègues cinéastes, de Steven Soderbergh à Bruno Dumont en passant par les frères Coen ?
En réalité, si j’étais honnête je dirais que mon rêve serait plutôt de partir à la retraite ! [Rires.] Très franchement, l’idée d’ajouter encore du travail à ce que je suis déjà en train de faire me fait un peu froid dans le dos. Je ne sais pas exactement quelle direction je vais prendre après ce film. J’ai envie de produire, de réaliser, mais j’ai surtout envie de cultiver mon jardin. Mais pour l’instant, j’avoue que je n’ai pas encore trouvé ce jardin.