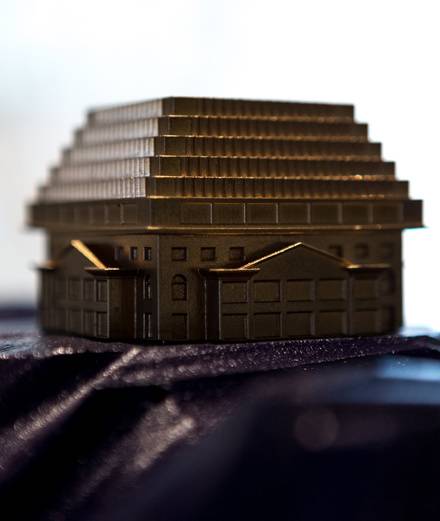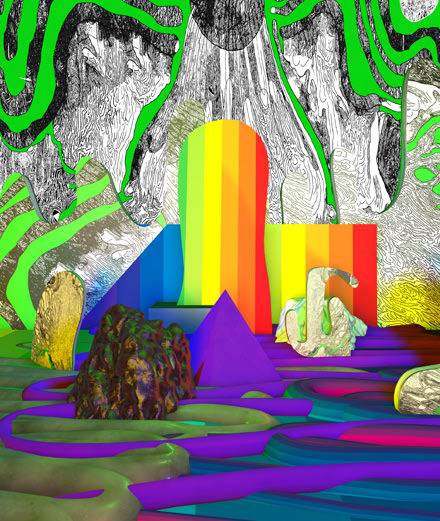La simple perspective de certaines expositions parvient par fois à susciter un désir immodéré. Pour celle que la Tate Britain (puis le Centre Pompidou) consacre aujourd’hui à David Hockney, 20 000 billets avaient déjà été vendus avant même son ouverture. Revenant en détail sur une carrière de presque soixante années, c’est en effet la plus grande manifestation jamais consacrée à cet artiste, qui traversa les modes avec indifférence… et leur survécut ! Les conservateurs durent, dit-on, livrer un âpre combat pour convaincre les prêteurs privés de se dessaisir de leurs peintures pour dix-huit mois… Le jeu devait en valoir la chandelle : il n’y avait pas eu de rétrospective consacrée à David Hockney depuis 1988.
“Il n’existait pas de peintures de Los Angeles. Les gens, alors, n’avaient même pas idée de ce à quoi cet endroit pouvait ressembler. Quand je suis arrivé, on était en train d’achever certaines autoroutes.” David Hockney
Historiquement, dans notre imaginaire, son oeuvre des années 60 et 70 est dominée par le bleu des piscines californiennes, qui éclate à la surface de A Bigger Splash (1967) ou de Portrait of an Artist (Pool with Two Figures) [1972], entre autres chefs-d’oeuvre. Hockney peint alors à l’acrylique, une technique plutôt nouvelle pour l’époque, qui ne permet pas de dégradés très précis, mais autorise de grands aplats colorés. Le miroir d’eau des piscines de Los Angeles – l’exposition en témoigne –, lui servit de prétexte à toutes sortes d’expérimentations picturales, la surface de la toile devenant le lieu d’une conversation entre la figuration et l’abstraction, tandis que les reflets de l’eau sont exprimés par des résilles ondulées de traits blancs – Peter Getting Out of Nick’s Pool (1966) –, ou qu’une bouée, soudain, devient le pivot d’une composition quasi abstraite – Rubber Ring Floating in a Swimming Pool (1971).
Hockney a toujours représenté ce – et ceux – qui l’entouraient : arrivé à Los Angeles en janvier 1964, il peignit alors des piscines, mais surtout produisit un portrait pictural (et photographique) de la ville. Comme il le souligne lui-même : “Il n’existait pas de peintures de Los Angeles. Les gens, alors, n’avaient même pas idée de ce à quoi cet endroit pouvait ressembler. Quand je suis arrivé, on était en train d’achever certaines autoroutes. Et je me souviens, la première semaine où j’étais sur place, de m’être dit en regardant une rampe d’accès qui aboutissait dans les airs : ‘mon Dieu ! ce lieu a besoin de son Piranèse. Los Angeles devrait avoir son Piranèse, et justement, me voilà !"


C’est toutefois en Angleterre que commença la carrière de David Hockney, qui naquit à Bradford en 1937. À la Bradford School of Art, en 1953, il apprit la peinture à l’huile, puis rejoignit le Royal College of Art de Londres en 1959. Les toiles de ses débuts frappent par le caractère ouvertement gay de leur narration, alors que l’homosexualité restera considérée comme un crime dans le pays jusqu’en 1967. Pourtant Two Men in a Shower (1963), The Most Beautiful Boy in the World (1961), We Two Boys Together Clinging (1961) ou l’imper tinent Cleaning Teeth, Early Evening (10 p.m.) W11 [1962], qui figure plus un 69 gay qu’un brossage de dents, ne font pas mystère des choix de sexualité qu’elles célèbrent.
Il fut associé, avec Richard Hamilton, à l’émergence du pop art anglais (qui précède le pop art américain), mais réfuta rapidement cette association, construisant ainsi un isolement stylistique qui, de toute évidence, compliqua la réception de son oeuvre : comment prendre au sérieux un type qui peint des piscines et un lifestyle désinvolte et hédoniste ? Comme l’explique Chris Stephens dans le catalogue de l’exposition : “Aussi légitime que soit le travail de Hockney, il est évident que, pour certains, la piscine du Chateau Marmont ou le front de mer de Fire Island soutiennent dif ficilement la comparaison avec les réflexions sur la violence politique de Richter ou les images d’armes et d’avions militaires de Celmins.
L'exposition consacrée à Picasso, qu’il vit à la Tate de Londres en 1960, eut sur lui une influence déterminante.
Dans les années 80, sa peinture figurative, et toujours perçue comme une survivance du pop art, ne connut pas un succès critique exemplaire. Confrontée aux styles dominants de l’époque et aux bouleversements infligés à l’histoire de l’art par le minimalisme et l’art conceptuel, elle embarquait, d’une manière décomplexée, Matisse et Picasso sous le soleil de Los Angeles, et fut moins considérée que les expérimentations qu’il menait alors avec de grandes compositions photographiques d’inspiration cubiste faites de Polaroid employés comme autant de points de vue simultanés d’une même scène. Il n’en fait pas mystère : l’exposition consacrée à Picasso, qu’il vit à la Tate de Londres en 1960, eut sur lui une influence déterminante. Ses toiles des années 90 semblent charrier l’obsession du point de vue (le cubisme de Picasso proposait d’en faire figurer plusieurs sur le même tableau) : peu de chances que la route figurée dans Garrowby Hill (1998) ait vraiment cette pente vertigineuse que nous voyons s’étirer depuis le point où la peinture nous installe.
Le paysage commence alors à s’imposer comme un thème majeur de son oeuvre. Sa palette, elle, s’aventure très littéralement vers celle de Matisse, tandis que triomphent des explosions colorées dans ses panoramas de canyons ou dans les représentations de la terrasse de sa maison de Los Angeles, comme dans Red Pots in the Garden (2000) – le même sujet se retrouve dans des toiles plus récentes, et la terrasse semble inchangée, avec sa rambarde et son deck bleus : Garden with Blue Terrace (2015).


C'est ainsi que, contre toute attente, en retournant vivre dans son Yorkshire natal dans les années 2000, celui qui incarnait le lifestyle californien (qu’il peignait volontiers d’après photographies) s’est mué en meilleur ambassadeur du paysage anglais et de la peinture en plein air, dans la plus par faite tradition de John Constable (1776-1837) ou de William Turner (1775-1851). Un paysage où, si plus personne ne figure, la présence de l’homme reste perceptible par des piles de bois coupé bien ordonnées ou des jardins impeccablement entretenus. En allant ostensiblement vers plus de classicisme, Hockney sembla manifester une grande indifférence à “l’art contemporain” qui, devenu exagérément populaire, autorisait désormais les formes d’expression les moins académiques.
“Quand je peins, j’ai toujours l’impression d’avoir 30 ans.” David Hockney
Plus tard, il réalisa aussi ces paysages à la palette graphique, puis sur iPad, et l’art contemporain lui pardonna cet insolent retour à la peinture de chevalet en extérieur. Il faut les voir, ses paysages des alentours de Bridlington où il réside : ils semblent porter en eux tous les pétillements de l’histoire de la peinture moderne ! Pour tant la palette colorée évoque par fois très nettement la porcelaine Windsor : A Closer Winter Tunnel, February-March (2006), par exemple, avec son rose tyrien feutré et ses gammes infinies de vert et de violet. Hockney enregistre les modifications du rythme des saisons, change de palette lorsque vient l’automne, retrouve au printemps les vert acidulés de Félix Vallotton… continuant à sa manière une oeuvre éminemment personnelle.
David Hockney a 80 ans cette année. Il fume comme un pompier et s’est taillé une sérieuse réputation dans le camp des fumeurs : c’est la première question qu’il vous pose, lorsque vous le rencontrez. Fumer crée un préalable très positif à la conversation, d’autant plus périlleuse qu’il est frappé de surdité depuis une quarantaine d’années. Les lois antitabac le désespèrent mais aussi l’indignent : il ne semble pas aimer les restrictions de liberté, quelles qu’elles soient. Il fume sans discontinuer, veille à ce que les cendres tombent sur son pull, précise qu’il ne sort plus dans les lieux frappés d’interdiction de fumer. Lorsqu’on lui demande : “Reconnaissez-vous l’artiste des débuts dans celui d’aujourd’hui ?” Il répond sans hésiter : “Oui, absolument. En effet, quand je peins, j’ai toujours l’impression d’avoir 30 ans.”