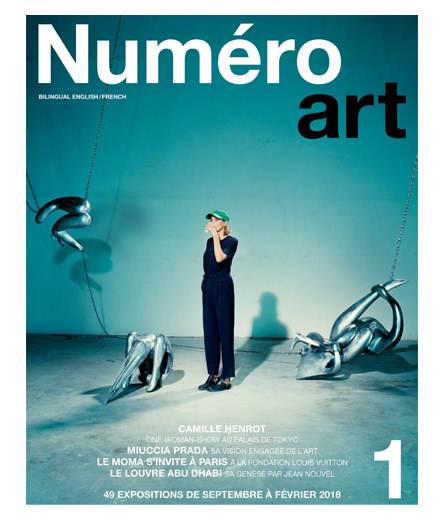À Londres, la Lisson Gallery est située dans un quartier un peu miteux tout près de l’artère Edgware Road. Malgré les théories sur le pouvoir de gentrification de l’art contemporain, Bell Street reste furieusement peu branchée. Cinquante ans après avoir ouvert ses portes, Lisson y a toujours comme voisins un grossiste en fruits secs, un réparateur de portables et une entreprise de pompes funèbres. Mais toutes les six semaines environ, la rue est envahie de tenues Comme des Garçons, de lèvres très rouges et de vin blanc pour un vernissage dans l’un des deux bâtiments de la galerie. Certains matins, très tôt, on a même aperçu Nicholas Serota, l’ancien directeur de la Tate, se hâter, manteau au vent, pour une visite à huis clos. Tous ces gens sont animés par la peur de rater quelque chose d’exceptionnel – motivation qui attire le public depuis 1967, lorsque plusieurs centaines de Londoniens avaient patienté devant les portes de la galerie pour y découvrir les œuvres de Yoko Ono.
Nicholas Logsdail, le directeur de Lisson, vit encore “au-dessus de la boutique”, comme dans les années 70 lorsqu’il y accueillait Sol LeWitt ou Dan Flavin en pleine préparation de leurs expositions. À l’époque, un directeur de galerie était un monsieur chic en costume à rayures, qui officiait dans les beaux quartiers de Mayfair. Logsdail avait fréquenté ce type de marchand d’art avec son oncle, l’écrivain Roald Dahl, qu’il accompagnait souvent dans les galeries. Mais ce n’est certainement pas ainsi qu’il se voit lorsque, à 22 ans, il ouvre un espace pour y exposer ses condisciples de la Slade School of Fine Art. “À la fin de l’adolescence, quand vous entrez dans la vingtaine, votre capacité de curiosité est illimitée, vous avez besoin de comprendre comment marche le monde, explique-t-il. Ma génération n’avait aucune idée de ce qu’était le marketing.”
“Il m’est clairement apparu, dans les deux ou trois premiers mois, que le monde dans lequel j’avais vécu était celui d’étudiants, qui certes aspiraient à devenir artistes, mais dont l’immense majorité laisserait tomber au bout d’un an pour faire autre chose”
C’est aussi grâce à son oncle que Logsdail rencontre Matthew Smith, et comprend que l’art sera sa vocation. L’artiste invite le jeune Nicholas, alors âgé de 8 ans, à fureter ou à peindre dans son atelier. “Il était incroyablement indulgent avec moi. Ce qu’il faisait m’intéressait passionnément. Cette odeur de peinture et d’essence de térébenthine, je ne suis pas près de l’oublier”, raconte Logsdail. Un paysage de Matthew Smith trône d’ailleurs dans son bureau. Il semble que comme artiste, Logsdail n’était pas non plus dénué de talent : l’une de ses œuvres a même été sélectionnée par la Tate pour l’exposition New Contemporaries, en 1966. “Pour faire un peu d’humour, je pourrais vous dire qu’avec une exposition à la Tate avant l’âge de 21 ans, ma foi, à quoi bon continuer?” s’amuse-t-il.


Depuis ses premiers contacts avec un monde de l’art à la veille de se métamorphoser, Logsdail s’est toujours servi de la galerie comme d’un laissez-passer pour explorer ce que pouvait lui offrir ce nouvel univers en s’engageant en facilitateur plutôt qu’en praticien. “Il m’est clairement apparu, dans les deux ou trois premiers mois, que le monde dans lequel j’avais vécu était celui d’étudiants, qui certes aspiraient à devenir artistes, mais dont l’immense majorité laisserait tomber au bout d’un an pour faire autre chose”, se souvient-il. L’année qui suit l’ouverture de sa galerie, il se rend en Allemagne puis à New York pour prendre la température, visiter des expositions et rencontrer des artistes.
Logsdail est alors convaincu que quelque chose de capital est en train de se jouer : la naissance de l’art conceptuel. “J’ai eu la chance inouïe de participer à ce moment historique, souligne-t-il. Ce qui se passait était pour moi une évidence. À Londres, à la fin des année 60, je doute que cela l’ait été pour beaucoup plus qu’une poignée de personnes – peut-être un ou deux commissaires d’expositions à la Tate. Je voyais la façon dont ce milieu de l’art en devenir commençait à tisser un réseau international complètement inédit. Le marchand d’art ‘dandy’ de Cork Street n’avait absolument pas conscience de ce qui se produisait.”
Encouragé par le succès de ses premières expositions, Logsdail s’enhardit à écrire aux artistes new-yorkais dont les œuvres l’emballent. “En 1971, le signal a été donné d’une prise de conscience artistique nouvelle, et nettement plus internationale, avec la première exposition de Donald Judd et Sol LeWitt.” Un effet domino s’amorce, qui permet à la Lisson Gallery de collaborer avec les plus grands artistes de l’époque :“Judd et Flavin se connaissaient, Flavin connaissait Dan Graham, Dan Graham connaissait Carl Andre, Carl Andre connaissait Sol LeWitt, Robert Ryman le connaissait aussi, et ainsi de suite.” En même temps qu’il expose leur travail, Logsdail les met en contact avec le milieu artistique britannique en les présentant aux artistes qui gravitent autour de sa galerie, et en les aidant à trouver des postes d’enseignants.
L’argent, lui, n’est clairement pas un problème. Logsdail n’hésite pas à financer à hauteur de sommes à six chiffres les projets les plus ambitieux de certains de ses “poulains”. Ce fut le cas pour Disposition, l’exposition d’Ai Weiwei organisée en 2013 en marge de la Biennale de Venise, ou pour Leviathan, d’Anish Kapoor, en 2011 au Grand Palais.
Aujourd’hui, pour attirer un artiste en terre étrangère, il faut se livrer à une cour assidue et complexe, impliquant de négocier avec les galeries qui jouent à domicile, et de s’engager à faire expédier les œuvres à grands frais par des spécialistes de la manutention d’œuvres d’art. Dans les années 70, les choses étaient assez simples. “En réalité, il suffisait d’entrer en relation avec les artistes, de leur envoyer un billet d’avion, et de bien vous occuper d’eux, se souvient Logsdail. C’est l’artiste qu’on faisait venir, pas l’œuvre.” Même si “s’occuper d’eux” pouvait réserver quelques surprises…
Ainsi, à l’occasion d’un séjour de Dan Flavin, Logsdail embarqua celui-ci pour un week-end à la campagne anglaise au volant de sa toute nouvelle DS. Ils visitèrent Stonehenge, mais ce qui passionnait Flavin, c’était la cuisine gastronomique : un luxe dont le jeune galeriste se rendit bien vite compte qu’il allait devoir le financer sur ses deniers personnels. Flavin avait repéré un restaurant étoilé au Michelin et réputé pour sa cave. “À 14h30, Flavin avait vidé une bouteille entière de château Lafite et achevé son menu complet. Il était ravi. Il m’a dit : ‘Tu sais, sur le plan gastronomique, c’est la plus belle expérience de ma vie’”, se souvient Logsdail, qui suggèra alors de se retirer dans leurs chambres pour une sieste. “Non, non, je n’ai pas envie de dormir, je veux recommencer!” J’ai répondu : “Quoi? Tu veux dire demain?” Et lui : “Non, tout de suite!” Sous les yeux d’un personnel médusé, Logsdail fit en sorte que Flavin puisse à nouveau déjeuner copieusement.


À la fin des années 70, la galerie de Logsdail devient celle de la nouvelle génération de sculpteurs britanniques, qui ont le même âge que lui : Tony Cragg, Richard Deacon, Richard Long. Ils sont rejoints au début des années 80 par Anish Kapoor, l’un des deux seuls artistes que Logsdail a fait entrer chez Lisson à la fin de sa formation artistique, comme il tient à le préciser. “Son travail était tellement singulier”, décrit-il – bien qu’il réfute le principe même de “découverte”. Pour lui, “le processus consiste à identifier les artistes qui ont commencé à définir un langage qui leur est propre, d’une façon convaincante et qui vous parle : c’est à ce moment-là que votre radar s’active.”
Dans cette même veine, la galerie compte parmi ses nouvelles recrues Marina Abramovic, qui, malgré sa renommée internationale, a souvent eu du mal à monétiser ses performances.
L’argent, lui, n’est clairement pas un problème. Logsdail n’hésite pas à financer à hauteur de sommes à six chiffres les projets les plus ambitieux de certains de ses “poulains”. Ce fut le cas pour Disposition, l’exposition d’Ai Weiwei organisée en 2013 en marge de la Biennale de Venise, ou pour Leviathan, d’Anish Kapoor, en 2011 au Grand Palais. Logsdail tient aussi à soutenir des artistes dont le travail est moins commercial. Lors de notre rencontre, l’une des galeries était occupée par un quadrillage de fil de fer barbelé en trois dimensions, conçu spécialement pour le lieu par Santiago Sierra. “C’est une œuvre capitale, emblématique, qui symbolisera peut- être un jour la triste période que traverse notre histoire”, avance le galeriste. Lors de sa première exposition chez Lisson, Sierra avait tout simplement bloqué l’accès à la galerie par une immense plaque en métal ondulé. Pour la plus récente, les conseillers de riches collectionneurs ont discrètement averti Logsdail que leurs clients voulaient de l’art qui soit agréable à regarder, et pas simplement “important”. Pourquoi, dans ce cas, montrer cette pièce de Sierra à la fois hostile et aliénante? “Parce que c’est une grande œuvre, et que Sierra est un grand artiste”, répond Logsdail.
Depuis 1970, la galerie représente John Latham, qui, on s’en souvient, avait dû abandonner son poste d’enseignant au Central Saint Martins en 1966 pour avoir emprunté à la bibliothèque universitaire un exemplaire de l’ouvrage de référence de Clement Greenberg, Art et Culture, dont il avait mastiqué les pages avant d’en restituer “l’essence” dans une fiole remplie d’une macération de papier et de salive. Cette année, Latham se voit inviter à la Serpentine Gallery de Londres et à la Biennale de Venise. En misant sur le (très) long terme, Logsdail avait clairement fait un choix judicieux.
Dans cette même veine, la galerie compte parmi ses nouvelles recrues Marina Abramovic, qui, malgré sa renommée internationale, a souvent eu du mal à monétiser ses performances. Logsdail l’a reçue chez lui sur l’archipel kenyan de Lamu, dans une maison qui a déjà accueilli plus d’un artiste en résidence informelle. Durant son séjour, elle a confié ses erreurs et ses errances à un âne qu’elle avait introduit dans la cour. L’âne est parti au bout d’une petite heure, et elle s’est sentie “un peu mieux”. Dans ce qu’Abramovic a pu écrire sur ses incursions londoniennes du début des années 70, elle confesse que Lisson était sa galerie préférée, mais qu’elle était trop timide pour adresser la parole au jeune homme de l’accueil; c’était Logsdail, qui deviendra son galeriste quarante ans plus tard.
Le cinquantième anniversaire de Lisson sera salué, cette année, par la publication d’un ouvrage imaginé par Irma Boom, et par une ambitieuse exposition hors les murs intitulée Everything at Once, qui combinera un “best of” avec des œuvres plus récentes et de nouvelles commandes, sur de multiples formats et supports. La galerie a désormais deux espaces à New York, ouverts à neuf mois d’intervalle en 2016 et 2017, et placés sous la responsabilité d’Alex, le fils de Logsdail. Le père ne compte pas pour autant se retirer de la gestion de la galerie. Comme pour démontrer son absence de snobisme (dont il affirme qu’elle lui vient de son ascendance norvégienne), Logsdail me propose aimablement de poursuivre notre conversation durant sa visite chez le podologue – tout ceci faisant partie, dit-il, d’un effort global visant à rester d’attaque pour entamer dans les meilleures conditions le prochain chapitre de l’aventure de Lisson. “D’une certaine manière, revisiter cinquante ans d’histoire de la galerie m’a réveillé. Je me sens plein d’énergie et j’ai envie de retrouver toute ma curiosité !” conclut-il.
Everything at Once, du 5 octobre au 10 décembre, Store Studios, 180 The Strand, Londres.